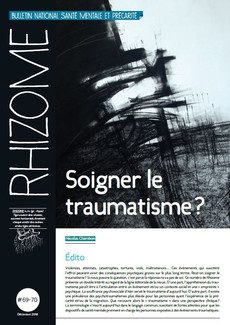Les crises humanitaires, telles que les situations de conflits armés ou les catastrophes naturelles, ont indéniablement des conséquences psychologiques ou émotionnelles sur les personnes. En français, le trauma signifie à la fois l’expérience objective d’un ou d’incident(s) critique(s) potentiellement traumatisant(s) et l’expérience subjective de l’effroi provoqué par ce ou ces même(s) événement(s). Ce double emploi a sans doute contribué au raccourci trop souvent fait entre traumatisme et trauma.
On parle en effet souvent de « populations traumatisées », comme si le mot trauma avait le pouvoir quasi magique d’attirer l’attention de la communauté humanitaire, des diplomates, des donateurs et des journalistes, le risque étant de le (sur)utiliser pour accentuer et renforcer une souffrance humaine. Si celle-ci est bien réelle, elle ne peut se réduire à la seule notion de « traumatisme psychologique » au détriment d’autres problématiques, notamment sociales (on ne peut nier les déterminants sociaux de la santé mentale), ou en passant à côté des manifestations psychologiques qui ne cadrent pas toujours avec celles décrites dans les manuels diagnostiques internationaux. En Palestine, où j’ai travaillé pendant plusieurs années, il n’est pas rare que le trauma s’exprime par les maux du corps – une façon légitime de gérer des émotions extrêmement douloureuses en lien avec la situation politique. On en arrive aussi à oublier que les personnes qui vivent dans des contextes fragiles et qui font face à l’adversité de manière soudaine et/ou continue peuvent développer des mécanismes de résilience. Méfions-nous donc des dérives qui consistent à penser de manière trop linéaire que les guerres, les catastrophes naturelles, les crises engendrent des traumatismes chez tous les individus.
Le concept de « traumatisme », ses théories et ses pratiques sont cependant utiles et peuvent bien entendu nous aider à comprendre et accompagner les personnes en souffrance. Ils ne sont cependant qu’une proposition parmi d’autres et ne sont pas prêts à l’emploi, par n’importe qui et n’importe où, comme on le constate parfois. En effet, une prolifération d’acteurs pseudo-humanitaires insuffisamment formés débarquent parfois suite à des crises majeures pour « soigner les populations traumatisées », sans nécessairement comprendre ni évaluer les enjeux et l’impact d’une telle démarche. Force est de constater que ce sont souvent ces mêmes populations qui, par leurs ressources, leur montrent le chemin vers la résilience.
Ceci étant dit, les crises humanitaires sont des opportunités pour non seulement soutenir les individus qui y font face sur le court terme, en les écoutant, en accueillant leurs émotions et en les reliant à leurs ressources de soutien naturel, mais aussi collaborer, sur le long terme, avec les gouvernements pour les aider à développer ou renforcer des politiques de santé mentale inclusives et des services proches de la communauté, et pour les aider à lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Dans la plupart des pays dans lesquels nous travaillons, il n’y a pas ou peu de politiques de santé mentale, il n’y a pas ou peu de structures pour accueillir les personnes en souffrance (quand elles existent, elles sont trop souvent en capitale et ne sont donc pas accessibles à la majorité) et pas de professionnels suffisamment formés. Au Sud-Soudan, par exemple, il n’y a qu’une psychiatre pour tout le pays. Il nous faut ainsi être très prudents lorsque nous intervenons en urgence dans ces contextes, car nous identifions des problématiques et des besoins que le pays n’a pas la capacité de prendre en charge. D’où l’importance d’un travail non seulement en urgence, mais également sur le moyen et le long terme au niveau des gouvernements (élaborer et/ou renforcer des stratégies et des lois en matière de santé mentale), des services (favoriser l’accès au soin et la qualité de ces soins) et des communautés. Le travail avec la communauté et par la communauté, en s’appuyant sur des ressources locales et en les renforçant, semble en effet une option à privilégier. Pour ne citer qu’un exemple, au Rwanda, suite aux conséquences du génocide, Humanité & Inclusion a travaillé avec la communauté, dans son projet « réunir les solitudes3 », en identifiant et en formant des « relais communautaires », personnes de confiance, qui ont mis en place des groupes de partage et d’accompagnement. Ces groupes ont permis de verbaliser des problématiques et de réactiver le tissu social pour apporter des solutions. Dans de nombreux cas, il est apparu indispensable, pour reconstruire une estime communautaire, de pouvoir répondre à des besoins de base qui n’étaient pas satisfaits. Il a donc été décidé de mettre en place, des « activités régénératrices de revenus » dans le cadre du projet de santé mentale. Un des groupes a, par exemple, créé un collectif où chacun investit 50 francs rwandais par mois.
En conclusion, les contextes fragiles dans lesquels nous travaillons nous amènent nécessairement à sans cesse repenser les interventions humanitaires, qui viennent également nourrir la réflexion sur la prise en charge du traumatisme dans notre propre culture. Reconnaître la tendance grandissante à la standardisation du savoir et des pratiques psychologiques autour du trauma, tout en tenant compte de la spécificité des besoins de l’être humain dans sa culture, guide certainement notre chemin4.
Notes de bas de page
1 http://www.maximilienzimmermann.org
2 Il s’agit du nouveau nom de Handicap International.
3 Un film a été réalisé par Handicap International et l’Agence française de développement pour présenter ce projet : http://www.youtube.com/watch?v=9qw2PRWr3Y0
4 Cette réflexion n’engage que son auteur et ne reflète pas la vision des organisations humanitaires pour lesquelles l’auteur apporte sa collaboration.