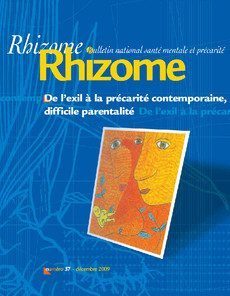La pensée psychanalytique, toujours soucieuse d’une anthropologie fondamentale qui dépasse les contraintes des monographies ethnologiques, vise l’horizon universel des rapports de cet être parlant, sexué et mortel qu’est l’homme aux lois fondatrices de son humanité.
Il n’empêche, il existe une pluralité d’expressions locales de cette culture « universelle » et nous rencontrons dans nos institutions d’accueil et de soin des sujets marqués par des symboliques de l’alliance, de l’appartenance et de la filiation, qui ne sont pas toutes équivalentes.
De plus, le lien « mère-enfant » peut être compris, même si c’est aller un peu vite, comme étant le lien où les enjeux de transmission des processus d’humanisation sont le plus à l’épreuve. A qui appartient l’enfant ? Que représente-t-il ? Quelle place joue-t-il dans le symptôme maternel ? Mais aussi et encore dans toute la gamme de représentations de l’ici et de l’ailleurs ? Quels lieux culturels, politiques et psychiques occupent-ils ces deux-là que sont mère et enfant, auquel de ces lieux l’enfant, ce représentant de la génération qui vient, est voué ou dédié, non sans paradoxes ou conflits ? Telles sont des questions qui se bousculent dans nos écoutes, nos soins, nos pratiques.
L’enfant et l’ancêtre ou lorsque le groupe ne fait pas médiation entre la mère et le nouveau-né
Andreas Zempleni et Jacqueline Rabin ont mis au jour une catégorie qui fait aujourd’hui florès dans certains cercles parisiens, « l’enfant-ancêtre ». Pour ces deux auteurs, nourris d’une culture méthodologique en anthropologie conséquente, il s’agit de respecter les termes coutumiers, cet enfant sera nommé « Nit Ku Bon » soit « l’enfant qui part et qui revient »1.
Mettons les points sur les « i ». Zempleni, un anthropologue, découvre qu’autour de certains enfants qui posent problème par leur mutisme, une étiologie traditionnelle est mobilisée. On dit: c’est l’esprit d’un mort, d’un ancêtre, qui revient. Zempleni est très prudent : c’est extrêmement rare. Car bien sûr, les familles n’avaient pas envie de s’encombrer d’ancêtres à tire-larigot et il fallait un certain nombre de consultations préalables avant de décider qu’un enfant était bien « l’enfant-ancêtre ». Or, transposée de façon mécanique pour penser les difficultés du lien mère-enfant chez des familles africaines en France, cette catégorie est devenue une machine à tout expliquer »2. L’idée n’est pourtant pas ici de demander aux anthropologues de définir des symptômes coutumiers qui permettraient de situer entièrement les troubles présentés par les patients africains. Ainsi, la catégorie de l’enfant-ancêtre, nom très répandu en région parisienne (93), de l’enfant « qui part et qui revient », appartenait surtout à l’observation anthropologique. Elle ne constituait pas un diagnostic clinique. Si elle a tant marqué – et si mal – les esprits des soignants ethnopsy, c’est aussi parce que la modernité pose de la façon la plus radicale qui soit la question « Qu’est-ce que procréer ? ».
Ce qui s’exprimait alors est que le devoir d’avoir une descendance ne recevait plus aucun encodage symbolique valide, ce qui laissait nombre de jeunes mères sans fiction pour éprouver paisiblement un possible désir d’enfant. Le petit corps mis au monde ne pouvant être accueilli comme descendant sera référé à l’ancestralité la plus occulte. De ce fait, l’enfant mis au monde n’est plus porteur de l’alliance entre deux lignées. N’étant plus ce lieu de tension entre l’affiliation (à une lignée) et la filiation (dans une lignée), il sera le lieu de retour de la part ancestrale mal célébrée dans une seule des deux lignées dont il est issu. On voit bien que ce thème de l’enfant-ancêtre, loin de n’être qu’un des items d’une nosologie traditionnelle, ne peut émerger que lorsque les pactes de solidarités d’une génération à l’autre sont bafoués.
Enfin, si la notion d' »enfant-ancêtre” désigne une façon d’inversion des générations, c’est alors une notion qui va très vite connaître une inflation ne renvoyant en rien à l’expression d’un fonds traditionnel. Déjà une étude poussée des textes magiques utilisés par les guérisseurs montre l’aspect ample et flou de cette représentation qui constitue seulement des suppositions pour les Wolof et les Lébou eux-mêmes. Se trouver diagnostiqué « enfant ancêtre » – ou plus exactement « enfant Nit Ku Bon »- signifie au final ne correspondre entièrement ni à une identité sociale, ni à une identité culturelle. Constamment le reflet de ses interlocuteurs, de leurs espoirs et de leurs angoissés, l’enfant, parfois promis à un grand avenir, parfois menacé de mort, est la cible privilégiée des projections de son entourage surtout lorsque l’enfant est un carrefour de tension entre la filiation (la ligne ancestrale à laquelle il est voué – et cela peut ne pas faire accord entre ses parents ou au sein de son groupe familial élargi) et l’affiliation (les lois et le jeu des échanges, des dons et des contre-dons entre les deux lignés tressées par le mariage dont il est le fruit).
Du rôle maternal à la parentalité
Bien des recherches qui sociologiques, qui anthropologiques ont pu décrire, non sans justesse et non sans nostalgie surtout, les arcanes symboliques et culturelles de ladite « famille africaine ». Et souvent, ce qui reste exact de l’Afrique en Afrique et moins, de l’Afrique en Europe exilée, il est fait mention du rôle dévolu à la communauté dans les pratiques de soin et d’éducation. Le voisinage, la famille élargie a sa part de responsabilité. L’autorité de la mère n’est pas pour autant réduite à peu. Bien au contraire, toutes les techniques de maternage, contrôlées par les femmes plus âgées, il est vrai, visent à apporter à l’enfant un sentiment de sécurité tout en lui inculquant, non sans rudesse parfois, les règles de la décence et de la propreté.
La première de ces techniques est le massage, laquelle renvoie à la symbolique du passage du corps « mou » ou au corps « façonné ». Le manque de tonus, bien plus que l’état de tension ou d’agitation du corps de leurs nourrissons et tout jeunes enfants alerte bien des mamans africaines. Le corps est façonné, non sans rudesse avons-nous le tort de penser selon, nos sensibilités précautionneuses (trop), et les parties du corps sont différemment traitées selon leur aspect réel et leur signification symboliques. Les massages diffèrent pour les petits garçons et pour les fillettes. Les gestes de la maman s’attardent sur le ventre de ces dernières comme pour saluer en elles leur future condition de mère. La seconde technique est le portage au dos. Le corps à corps est important, l’enfant souvent est porté dans le dos de sa mère, mais il passe aussi aisément de mains en mains que de dos en dos. Quant à la technique du sevrage elle est selon les peuples, brutale ou graduelle. Une constante est que l’enfant est plus tardivement qu’en Europe nourri au sein, et ce, à sa demande.
Au reste, le père n’a pas cette fonction d’interdicteur du contact, il ne vient pas brider l’éveil de la sensualité. L’autorité du père est abstraite mais hautement respectée. Il ne fera sentir sa désapprobation et ne rappellera le jeune contrevenant à la loi qu’en cas d’infractions graves, pouvant nuire à la réputation du clan et donc de la lignée (vol, violences). Très souvent ce sont les frères ou les cousins aînés, ou même les frères ou cousins de la mère qui rempliront l’office du gardien des règles usuelles de bonne conduite ordinaire. L’exil va brouiller de tels repérages, et les pères en exil diront souvent à quel point il leur est ardu de supposer qu’ils puissent faire passer les lois du pays dit d’« accueil » à leurs progénitures ce qui donnent aux femmes et aux mères une place d’autorité plus forte souvent que celle qu’elles auraient pu exercer au pays. Ce vaste panorama, réaliste, mais extrêmement réducteur, est déjà, grandement effrité en Afrique même dans les mégapoles où les familles sont loin de se conformer à ces schémas d’harmonie coutumière. Cela peut être d’autant souligné, poursuit-il, que nombre de femmes et d’hommes qui ont quitté l’Afrique pour l’Europe ont séjourné, pour une durée plus ou moins longue, et souvent décisive, dans ces mégapoles que sont Dakar, Bamako ou encore Brazzaville ou Kinshasa.
Dans les mégapoles les modifications du « conjugo », la déstructuration des liens familiaux et la haute solitude de certains mineurs
Les mégapoles sont, en Afrique comme ailleurs en ce monde, des laboratoires infatigables de nouvelles formes de parentalité. Ce qui est certain est qu’elles individualisent et que s’y inventent des façons de bien aller, ou d’aller malade, de raisonner ou de déraisonner qui mettent en œuvre des processus de trouage des symboliques collectives par des symboliques individuelles ou étroitement familiales. Aussi la connaissance ethnologique fondée sur l’étude du village est d’une aide que nous devons tempérer. Bref, la famille traditionnelle est éclatée. Le mariage apparaît depuis au moins une génération comme une union entre deux êtres autant sinon davantage que comme une alliance entre deux lignées. Les initiations traditionnelles ne concernent plus beaucoup de préadolescents ou d’adolescents. Partout où l’Islam s’est imposé, les règles du droit musulman priment sur les contraintes coutumières. Les mutilations sexuelles sont progressivement dénoncées comme des violences et des campagnes d’information s’étendent au Mali, Niger, Sénégal. Reste des inerties, les droits de la femme sont plus souvent proclamés dans des colloques et des réunions politiques qu’ils ne sont une réalité, même si la participation grandissante de femmes dans les divers gouvernements semble jouer comme un salutaire facteur d’évolution des mentalités et des mœurs.
Tout n’est cependant pas si heureux. A la pauvreté des campagnes succède souvent la précarité des villes. Se marier coûte cher, et nombre de familles ont un rapport très mercantile à la dot. Plus celle-ci est élevée, plus on espère un gain, plus le mariage devient retardé. Si la polygamie est en recul, on la voit résister sous des formes différentes. L’une peut surprendre. Elle semble être un choix de certaines jeunes femmes qui se considèrent comme émancipées ou intellectuelles et qui peuvent l’être et qui voient dans la solution polygame une façon de ne pas être quotidiennement accaparées par les tâches du foyer et de la conjugalité. Mariées, elles sont respectables, et mariées comme seconde ou troisième épouse et en conséquence pas systématiquement assujetties à vivre sous le même toit que leur mari, elles peuvent mener leur vie, continuer leurs études, persévérer dans leur exercice public de journaliste ou de femmes politiques.
De telles options peuvent déconcerter le lecteur occidental, mais elles n’occasionnent ni troubles, ni violences. Bien plus inquiétants sont des cas de polygamies qui sont de véritables passages à l’acte, l’intrusion d’une nouvelle épouse valant presque répudiation de l’ancienne épousée, qui vit dans une réclusion dépréciatrice et déprimante, les enfants du premier lit étant, eux aussi, souvent vécus comme des indésirables. Bien des fugues d’adolescents, ou de plus jeunes encore qui commencent une carrière d’enfants des rues s’expliquent de la sorte3. A cela s’ajoute aussi la situation particulière de certains enfants, confiés, comme c’est l’usage, à un maître d’école coranique chez qui ils vivent en pension. Ces écoliers, qu’on nomme « talibés » sont loin de se trouver correctement traités tant nombre de ces écoles ne sont plus que ces centres d’entraînement à la mendicité – réalité qui inquiète légitimement des maîtres d’école coraniques responsables et qui cadrent et protègent bien les jeunes dont ils ont la charge. Aussi ceux des mineurs qui « tombent » dans des lieux où à défaut d’apprendre quoi que ce soit du coran, ils sont copieusement maltraités, fuguent, et ne veulent plus se présenter chez eux, soit par honte d’avoir fait échouer l’idéal dont ils étaient porteurs, soit parce qu’ils interprètent, non sans raison parfois, leur placement dans de telles écoles maltraitantes comme un abandon pur et simple. Le Dr. Modibo Coulibaly rapporte à quel point le talibé rapidement devient un vagabond redoutant le foyer, et l’école, et s’agglutinant dans la rue à d’autres jeunes fugueurs4.
Mineurs en danger dans la rue
Avant que de décrire plus avant une situation africaine, une précaution dans le choix des termes s’impose. « L’enfant des rues » est à la mode. Il est devenu la valeur refuge de nos compassions. Or s’il y a des mineurs en situation de rue, certains y sont en danger, sporadiquement ou continûment, d’autres très peu. D’emblée est à noter que cette expression « enfant des rues » est vite devenue un fatras notionnel où se récupèrent, sous le nom de « résilience », une psychologie du moi fort et, sous l’idée absurde d’une « culture des enfants des rues », un sociologisme décoratif qui aborde vainement ces préformes de communauté déliquescente ou balbutiante comme on le ferait de « sous-culture ». Tout cela sombre dans un scientisme publicitaire pour ONG. Rappelons donc que les mineurs en danger en situation de rue sont loin d’être toutes et tous des enfants. La plupart d’entre eux sont des adolescents. Pris dans la dimension de la puberté, de la sexualité et de la violence sexuelle, mais aussi du sida qu’ils peuvent transmettre à leurs partenaires ou encore à leur progéniture dans le cas des maternités précoces. Et ce ne sont plus des sujets seulement concernés par les solutions et les embarras de la sexualité infantile5. On le voit déjà, cette notion « enfants des rues » est une expression commode qui refoule le sexuel en angélisant la victime. Et il n’est point à s’étonner que ce soit au sein des équipes de soin et d’éducation qui ont su développer un réel savoir-faire avec les mineurs adolescentes en rue, des deux sexes, que l’expression « enfants des rues » a une presse faible ou mauvaise. Je suis scientifique, je n’ai cure d’inventer du concept pour faire joli, par goût de l’originalité. Au contraire, c’est bien en forçant les savoirs, en situant les points où ils ne répondent plus très bien, qu’il est nécessaire de se résigner à inventer des nouveaux termes plus aptes à décrire les faits et à permettre l’action.
Que se joute-t-il sur nos terrains de recherches et d’action ?
La vie dangereuse dans la rue modèle des comportements ; plus profondément, elle met en forme des processus psychiques particuliers qui aident à la survie parfois, mais au prix de clivages, de dénis et de retraits psychiques exténuants. Il faut distinguer ces deux plans sauf à céder à l’illusion d’une correspondance univoque entre processus psychique et comportement ce qui est une absurdité. Face à des sujets aussi démunis, aussi peu assurés du sentiment de se sentir réels, aussi mal accueillis dans la vie, nous avons à inventer et à mettre à l’épreuve de l’action une approche clinique. Les savoirs psychologiques et psychopathologiques nous y aident, à mesure toutefois qu’ils se trouvent questionnés, qu’ils rencontrent la limite de leur extension et de leurs articulations internes.
Des jeunes en danger donc. Il y a différents types de dangers, et les plus immédiatement repérables sont ceux qui mettent le corps en danger et qui congédient de l’usage que le jeune fait de son corps les savoirs communs nécessaires à la survie. Il faut ici noter les particularités de la vie sexuelle de nombre de ces jeunes. Il existe une sexualité dans les groupes de jeunes en errance, et c’est une réalité difficile à admettre et longtemps passée inaperçue. Les enfants en parlent peu tant cela va contre certains tabous sociaux et culturels et tant cela dépasse aussi – et c’est plus important – leur propre capacité de représentation de leur corps. La sexualité peut être utilisée comme un moyen de sujétion et de contrôle des aînés « protecteurs » sur les plus jeunes. De plus, à l’adolescence, certains jeunes, surtout des filles, ne disposent pas d’un savoir et d’une image de leur corps qui les rendent aptes à « métaboliser » les irruptions pubertaires. Il faudrait évoquer ici la dimension de cette sexualité adolescente lorsque la signification phallique du désir est si peu assurée. Leur sexualité devient alors souvent une conduite stéréotypée et à risque qui a pour but de calmer, par la répétition de l’acte sexuel, ce traumatisme que peut représenter l’irruption dans leur corps de la sexualité génitale. On rencontre là un paradoxe fréquent chez ces jeunes exclus des discours partagés et privés des possibilités identificatoires qu’offrent de tels discours : ils soignent leur anxiété par de l’agir. Ce point est important à connaître pour quiconque prétend travailler dans la prévention et/ou l’accompagnement psychoéducatif avec de jeunes adolescents et adolescentes.
Envisageons un problème crucial pour notre action de « secourisme social » éclairée, comme il se doit, par des enseignements cliniques et psychopathologiques. En effet, c’est bien quand un sujet refuse un bien auquel il a droit qu’on se rend compte que la prise en charge d’un sujet cassé, si elle « passe » en premier lieu par le soin du corps, ne saurait être effective s’il n’est pas fait accueil d’une souffrance psychique. Or, nous rencontrons aussi des sujets en souffrance psychique qui ne ressentent rien, et c’est bien cela le paradoxe de l’anesthésie. C’est avec ces mineurs qu’il faut travailler en premier lieu, ce sont les plus en danger. De tels enfants ont souvent le sentiment qu’ils n’ont pas été complètement mis au monde. Au-delà de l’exclusion économique, sociale et familiale, ils ont le sentiment, la conviction presque d’être mis à la porte du langage, des échanges ordinaires, ces échanges qui nous font nous sentir vivants. Il s’agit grave d’une atteinte du sentiment d’identité du narcissisme primaire, lequel est d’abord composé non d’une image mais d’une régularité de rythmes permettant par la suite d’assumer une image.
N’oublions pas qu’il faut se sentir très rassuré pour parler de soi. Et avoir été « parlé » au sein de sa famille, avoir été bercé par le langage maternel, puis concerné par ce que les parents disent, reconnus par eux comme un être digne de parole. La rupture précoce des liens familiaux peut trop souvent s’accompagner d’une « casse » des paroles qui concernent l’enfant, soit les mots qu’il pourrait dire, soit ceux qu’il serait en droit d’attendre. Cela laisse des marques. Plus tard, certains jeunes ont la conviction que s’ils parlent d’eux il va leur arriver un malheur. Ils ont du mal à faire confiance à la parole, à ses pouvoirs apaisants et structurants ; ils ont été si peu rafraîchis à l’eau douce du dire partagé ! De plus, ils redoutent qu’en parlant trop de leur origine de leur famille, on ne veuille par excès de bons sentiments les ramener tout de suite chez eux. Il est alors inepte et nocif de les aborder avec des protocoles de conversation visant à les étudier sur le mode d’une étude de population. En effet, posons nous la question de qu’est pour eux le « chez soi », le « nous », le « commun » (toutes cas catégories qui fonctionnent comme cadre pour une jeunesse normale dans une famille à peu près étayante) ? Ce « chez soi » n’a pas fonctionné comme une catégorie d’expérience situant la possibilité d’un lieu intime et protecteur dans le rapport de soi à soi et de soi aux autres.. Nous avons peu affaire à des fugueurs, c’est-à-dire à des jeunes qui font une partie de cache-cache avec leur famille et leur maison familiale. Non, ces jeunes naufragés dans la rue et qui nous alertent sont des enfants qui ont échoué leur fugue et l’ont transformée en errance, la maison n’est plus un point de retour possible pour eux. Du moins, pas tout de suite6.
Pour une action fondée en raison.
Comment aider ces jeunes en guidant nos actions par un repérage clinique ?
Pour répondre à cette question, je vais prendre l’exemple d’une adolescente « des rues » rencontrée par moi à Bamako et qui avait demandé à une équipe spécialisée dans la prise en charge des adolescentes en errance7 à aller voir sa mère à Ségou, ville distante de près de 200 kilomètres de là. Arrivée sur place, avec l’éducatrice, la famille n’était pas là, la maison d’« enfance» était introuvable. La jeune et son éducatrice errent jusqu’au moment où une riveraine reconnaît la jeune fille et lui demande pourquoi elle n’est pas avec sa mère, laquelle vit à Bamako. Révélation ! L’éducatrice ne s’est pas fâchée contre la jeune fille, mais lui a demandé si elle avait fini ses affaires et ses racontars avec Ségou ou si elle avait quelque chose d’autre à raconter. La jeune fille a alors expliqué qu’elle avait une tante décédée qui vivait avant à Ségou. Il semble que cette tante soit la seule figure aimante maternelle que la jeune fille ait connue. On pourrait dire « cette fille ment », mais en réalité sa demande contient le cœur de sa vérité d’enfant. Ségou est le lieu où il reste, pour elle, possible de retrouver une trace de maternage. Seulement voilà, une trace psychique ne consiste pas (ne résiste pas à son effacement) si elle n’est pas lue par une autre ou par un autre que le sujet. D’où le sens inconscient de ce voyage. Je suis admiratif devant la profondeur humaine et la sagesse de son éducatrice, encore maintenant.
Le jeune a donc besoin de temps pour passer de la fiction à la réalité. Et nous voyons que ce temps est, de fait, triple :
- préserver un noyau de traces réelles structurantes dans une fiction,
- vivre cette fiction comme une construction en partage, adressée à un autre, mais le sens de tout ce montage reste inconscient tant que le sujet ne fait pas le lien entre l’écorce de fiction et le noyau de réel qui le concerne en propre,
- entrer dans un temps d’historisation de sa propre vie, ce qui ne se fait que si le sujet a pu reconstruire une relation de parole pleine avec un adulte aidant.
Bref, il ne va pas de soi de prendre la parole, c’est-à-dire de retrouver goût à la demande. Les jeunes en danger dans la rue ressentiront souvent une angoisse par rapport au langage partagé avec l’adulte, et pour ceux qui sont vraiment en danger dans la rue, ils n’ont plus confiance dans le pouvoir de la parole. Au reste, on les voit souvent bégayer. Tout ce qu’on leur demande leur fait peur ; du coup, dans un premier temps, ils vont nous « décevoir » et ne pas nous répondre. De telles attitudes dites « d’opposition » sont faites pour nous tester, pour nous apprivoiser, tant il est vrai que c’est aussi ces jeunes qui nous apprivoisent. Ils nous testent et observent afin de vérifier si cette déception qu’ils peuvent faire naître, en n’étant pas là, en ne prenant pas nos conseils au pied de la lettre, si cette déception donc ne va pas être transformée par nous en violence contre eux.
Ne pouvant anticiper une altérité fiable, ces jeunes clivent la figure du prochain en un semblable, un pair auquel ils se raccrochent et un non-semblable, l’adulte le plus souvent vis-à-vis duquel ils se protègent. Cette protection se fait sur le mode d’une récusation de ce que l’on peut demander à cet enfant : se laisser nourrir, se laisser soigner. De cette offre, ils ne veulent d’abord pas. Dans le même mouvement, ces enfants se présentent comme sans aucune demande et presque indifférents aux divers besoins de soin, de sommeil et d’alimentation dont ils témoignent à leur corps défendant. Ce masque d’indifférence manifeste se lézarde, toutefois, dès que nous tenons le coup et maintenons notre offre. Ce jeune distant, superficiellement indifférent car survivant dans un univers indistinct, nous met alors sous les yeux toute l’angoisse qui l’habite. Angoisse ressentie par rapport à ce qu’on lui veut, certes, mais plus profondément encore angoisse de mort – laquelle se manifeste et redouble de férocité dès que le jeune est convié à entrer plus avant dans le devenir et dans la vie. Et les premiers liens retressés avec un monde adulte enfin contenant peuvent aussi mener à des expressions d’une détresse très impressionnante devant le Surmoi, c’est-à-dire devant cet aspect de la conscience morale fait de honte et de culpabilité et qui exige un prix à payer très fort pour que le sujet vive en paix avec autrui. Ces jeunes peuvent rapidement vouloir rembourser une dette de vie en s’imaginant qu’ils doivent accomplir des exploits, se mettre en risque à nouveau, pour bénéficier de la protection d’un milieu familial ou institutionnel.
Les jeunes, la rue, le SIDA
Enfin, la présence effrayante du virus du SIDA a joué un grand rôle dans les nouvelles configurations des rapports des mères et des enfants. Le SIDA é été une arme de guerre dans toute la région dite de l’Afrique des grands lacs, et en République Démocratique du Congo (ex Congo Belge). Les miliciens ougandais étaient recrutés sur le critère de leur séropositivité. Leur tâche étaient d’exterminer les hommes mais aussi de contaminer les femmes par les viols, de leur « donner la maladie » comme l’indiquaient les termes mêmes de la propagande. Le viol comme arme de guerre a causé une mortalité terrible de femmes et d’enfants. Celles qui en sont rescapées se retrouvent dans des positions intenables au plan des légitimités coutumières, violées, déshonorées, porteuses de mort, peu et mal soignées, elles ne sont que très rarement et très mal réinscrites dans la vie sociale antécédente. Souvent certaines se regroupent en association, certaines en ONG, visant à soutenir leurs compatriotes laissées dans la même condition qu’elles, et elles ont à cœur de développer des réseaux d’informations et d’entraide qui concernent aussi les jeunes filles, tant après la fin des hostilités (2004) l’ensemble des relations sexuelles dans ces régions semble être encore marquée par la crainte et la violence8.
Il y a encore à rapporter les effets du VIH Sida auprès de jeunes filles vivant de prostitution plus ou moins occasionnelle dans la rue des mégapoles de l’Afrique de l’Ouest. Travaillant régulièrement avec les équipes du Samu Social Mali -ONG que j’ai en grande part fondée en 2000 et 2001, sous la direction de Xavier Emmanuelli9 et avec l’aide de Guy Jehl, Delphine Laisnée et Marine Quenin- je constate à quel point une jeune fille atteinte du Sida développe souvent, à la mort de son enfant infecté, une attitude paradoxale vis-à-vis des équipes sociales qui tiennent à s’occuper d’elle. Situation de « blocage », précise intelligemment Madame Gagnoua Sow, travailleuse sociale au Samu Social Mali, dans un mémoire fait tout récemment sous ma direction10. Elle désigne par cette expression une situation où la jeune a besoin d’un contact régulier avec l’équipe mais pour ne pas changer. Souvent la subjectivité ravagée se fige sur une position mélancolique persécutée qui fait que soit la jeune fille montre à l’équipe à quel point elle doit se laisser mourir, soit à quel point elle doit se venger de ce qu’elle a subi en faisant de sa séduction une arme de guerre et de son corps une arme de mort, contaminant dans sa folie mercenaire les clients du soir au matin. Seuls de longs entretiens avec ces femmes du Samu permettent à ces jeunes filles d’élaborer leur chagrin et de se restaurer par transfert une image de féminité possible. Reste alors tout le champ de la réinsertion dans une société souvent violente et méprisante vis-à-vis de telles malheureuses11.
Conclure
Au Mali, au RDC, au Niger, au Brésil, ou ailleurs j’ai pu, avec d’autres médecins et chercheurs, assister à l’éclosion de petites associations ou institutions. Elles sont fondées et dirigées par des femmes intelligentes et dévouées qui savent, à leur façon, au plus près des réels, faire bouger les préjugés et réhumaniser les liens entre sexuel et filiations, si rudement entamés par le VIH, la guerre et pire encore par la conjonction entre ces deux fléaux.
Le terrain d’un possible dialogue entre cliniciens et anthropologue se situe à un niveau épistémologique c’est-à-dire qu’il nécessite que soient formalisées les conditions de la production du savoir. Si ce pas ne s’accomplit pas, il est à prévoir et il est à craindre que l’ethnologie et la psychologie interculturelle clinique ne soit plus pensées que comme science d’approche de sujets issus de sociétés non dissoutes dans le système capitaliste. Ce qui est assez chimérique, voire dangereux.
De plus, un tel dialogue pourrait redonner chance aux ambitions, aujourd’hui malmenées, de la psychothérapie institutionnelle qui toujours a misé, dans le traitement institutionnel de la folie, sur la réhabilitation du sujet en tant qu’agent de la culture et producteur d’un social. Un tel pari, qui mise sur la consistance symbolique de la personne de l’aliéné a des connotations politiques flagrantes. Ces dernières se révèlent et peuvent s’articuler, surtout lorsqu’il s’agit de prendre en compte ce qu’affiche d’ambition et de projet politique la façon dont il est fait part ou non aux singularités des référents symboliques dans la prise en charge psychothérapeutique et sociothérapeutique de sujets jamais considérés pour autant comme des modèles achevés et stéréotypés de leur supposée culture d’origine. Ainsi, donner droit de cité à la langue maternelle, à l’histoire des violences et des dénis d’identité qui, collectivement, ont pu marqué l’existence de telle ou telle personne, dans sa rapport à la parole et à autrui, est une des fonctions les plus éminentes de l’institution soignante, ce qu’incarnait exemplairement le parcours d’un Fanon . Or, cette fonction est de plus en plus menacée par des impératifs gestionnaires auxquelles de trop nombreux psychiatres, réduits à une pauvre autorité médicale et administrative, se soumettent à l’aide souvent de la passive complicité de bien des psychologues « new-age »12.
Notes de bas de page
1 Andras Zempléni (l’interprétation et la thérapie traditionnelles du désordre mental chez les Wolof et les Lebou (Sénégal), Thèse de 3ème cycle, 1968, 2 tomes.
2 Olivier Douville, « Quelques remarques historiques et critiques sur l’ethnopsychiatrie ». Journée de l’Ecole de Ville Evrard (EVE) « Quand la folie parle une autre langue » http://ecoledevilleevrard.free.fr/, juin 2000
3 Olivier Douville : « L’urgence, le trauma. A propos du travail clinique avec des enfants errants dans les rues de Bamako », Victimologie-Criminologie, Approches cliniques, Tome 5 « Situation d’urgence-situation de crise. Clinique du psychotraumatisme immédiat » (sous la dir. de François Lebigot et Philippe Bessolles), Nîmes, Champ Social éditions, 2005 : 103-112.
4 « Enfants des rues à Niamey, une exploration psychosociologique » : Congrès constitutif de la Société Nigérienne pour la Santé Mentale, Hôpital National de Niamey, novembre 2009.
5 Une toute récente mission à l’hôpital psychiatrique de Niamey m’a, en revanche, permis de rencontrer des psychiatres et des psychologues avertis de ce que c’était bien autour de la question de l’adolescence errante que la pédopsychiatrie pouvait inventer des dispositifs de liens et d’assistance aux mineurs en danger dans la rue, ce en lien avec les ONG Caritas. Cette même semaine de novembre/ décembre 2009 vit le lundi 30 novembre, sous l’impulsion du docteur Douma, la mise en place de la société nigérienne pour la santé mentale qui donna lieu à des conférences sur les mineurs en danger dans les rues, et les adolescences en errance pathogène.
6 Olivier Douville« Errance humaine, cas des jeunes en situation de rue », Congrès constitutif dela Société Nigérienne pour la Santé Mentale, Hôpital National de Niamey, novembre 2009.
7 ONG APAF Muso Danbé, dirigée par Jacqueline Goita, dite « Madame Urbain » et dite aussi « Maman ».
8 Olivier Douville, intervention au DIU « Abords des mineurs en danger dans la rue », Samu Social International, Universités de médecine Paris VI et Paris XII, 2009.
9 Président du Samu Social International
10 Gaouagna Traoré Sow « Le blocage… comparaison Nord/Sud » mémoire de DIU, « Abords des mineurs en danger dans la rue » Samu Social International, Universités de médecine Paris VI et Paris XII, 2009.
11 Gaouagna Traoré Sow, op. cit.
12 Olivier Douville « Clinique des altérités : enjeux et perspectives contemporaines », Psychanalystes, gourous et chamans en Inde (sous la dir. de Patrick Bantman, Alain Deniau et Didier Sabatier), Paris, L’Harmattan, 2007 : 67-77.